 Dans
le système mis en place par Helenio Herrera au milieu des années 60, le
libero était censé évoluer entre la défense et le gardien et colmater
les brèches en assurant une couverture sur toute la largeur du terrain
(d'où le terme anglais de "sweeper"). Armando Picchi, défenseur de
l'Inter de 1960 à 1967 et clé de voûte du catenaccio, peut être
considéré comme le premier grand libero moderne. Par la suite,
Beckenbauer va réinventer le poste, et faire du numéro cinq un
joueur plus porté vers l'avant et la construction du jeu, à la
fois leader technique et premier relanceur de son équipe. Avec la
systématisation de la défense en ligne, le libero bénéficie d'une
liberté moindre et évolue comme deuxième défenseur central aux côtés du
stoppeur. Si ce dernier doit avant tout s'acquitter des sales besognes
et faire parler ses qualités physiques, on attend du libero qu'il brille
par son aisance technique et sa qualité de passe, qu'il rassure par son
placement et son sens de l'anticipation et garde son calme en toutes
circonstances. Complets et polyvalents, les plus grands joueurs à ce
poste sont souvent d'anciens milieux de terrain qui ont reculé d'un
cran.
Dans
le système mis en place par Helenio Herrera au milieu des années 60, le
libero était censé évoluer entre la défense et le gardien et colmater
les brèches en assurant une couverture sur toute la largeur du terrain
(d'où le terme anglais de "sweeper"). Armando Picchi, défenseur de
l'Inter de 1960 à 1967 et clé de voûte du catenaccio, peut être
considéré comme le premier grand libero moderne. Par la suite,
Beckenbauer va réinventer le poste, et faire du numéro cinq un
joueur plus porté vers l'avant et la construction du jeu, à la
fois leader technique et premier relanceur de son équipe. Avec la
systématisation de la défense en ligne, le libero bénéficie d'une
liberté moindre et évolue comme deuxième défenseur central aux côtés du
stoppeur. Si ce dernier doit avant tout s'acquitter des sales besognes
et faire parler ses qualités physiques, on attend du libero qu'il brille
par son aisance technique et sa qualité de passe, qu'il rassure par son
placement et son sens de l'anticipation et garde son calme en toutes
circonstances. Complets et polyvalents, les plus grands joueurs à ce
poste sont souvent d'anciens milieux de terrain qui ont reculé d'un
cran.
Franco Baresi (Italie, né en 1960)
 Homme
de base de l'hégémonique Milan AC d'Arrigo Sacchi et relais tactique de
l'entraîneur sur le terrain, l'incoutournable Franco Baresi a toujours
plus ou moins donné l'impression d'avoir cinquante berges. Formé au
club, il est resté fidèle toute sa carrière au maillot rossonero sous
lequel il a disputé plus de 500 matches, remportant trois Coupes
d'Europe et six Scudetti. Promu capitaine de l'équipe à 22 ans
seulement, Baresi compense ses lacunes physiques et son manque de
vitesse par un sens unique du placement et une grande autorité
naturelle, et devient pour les tifosi une sorte de porte-drapeau
identitaire.
Homme
de base de l'hégémonique Milan AC d'Arrigo Sacchi et relais tactique de
l'entraîneur sur le terrain, l'incoutournable Franco Baresi a toujours
plus ou moins donné l'impression d'avoir cinquante berges. Formé au
club, il est resté fidèle toute sa carrière au maillot rossonero sous
lequel il a disputé plus de 500 matches, remportant trois Coupes
d'Europe et six Scudetti. Promu capitaine de l'équipe à 22 ans
seulement, Baresi compense ses lacunes physiques et son manque de
vitesse par un sens unique du placement et une grande autorité
naturelle, et devient pour les tifosi une sorte de porte-drapeau
identitaire.Lorsqu'il prend sa retraite en 1997, les dirigeants milanais décident de ne plus jamais attribuer son numéro 6. Sélectionné à 81 reprises avec la Squadra Azzura entre 1980 et 1994, il est sacré champion du monde sans jouer une minute en 1982. Douze ans plus tard, après avoir manqué quasiment tout le tournoi sur blessure, il signe après s'être fait opérer un superbe retour en finale face au Brésil, mais expédie son tir au but dans le ciel de Pasadena.
Franz Beckenbauer (Allemagne, né en 1945)
 Incarnation
absolue de l'élégance footballistique, cet aristocrate des
pelouses figure tout simplement parmi les plus grands joueurs de
l'histoire du jeu, tous postes confondus. Ultra-polyvalent et
techniquement très au-dessus de la moyenne, Beckenbauer évolue d'abord
comme ailier ou latéral gauche avant de signer une brillante Cup 1966 en
tant que milieu de terrain puis de s'installer définitivement libero à
la fin des années 60. Doté d'une grande intelligence tactique, il
révolutionne le poste et devient pour son équipe une sorte de chef
d'orchestre et d'organisateur suprême, capable de distribuer le jeu, de
monter lui-même le ballon, de coordonner les phases offensives et
défensives.
Incarnation
absolue de l'élégance footballistique, cet aristocrate des
pelouses figure tout simplement parmi les plus grands joueurs de
l'histoire du jeu, tous postes confondus. Ultra-polyvalent et
techniquement très au-dessus de la moyenne, Beckenbauer évolue d'abord
comme ailier ou latéral gauche avant de signer une brillante Cup 1966 en
tant que milieu de terrain puis de s'installer définitivement libero à
la fin des années 60. Doté d'une grande intelligence tactique, il
révolutionne le poste et devient pour son équipe une sorte de chef
d'orchestre et d'organisateur suprême, capable de distribuer le jeu, de
monter lui-même le ballon, de coordonner les phases offensives et
défensives.Son influence rayonnante et ses qualités de meneur d'hommes portent le Bayern Munich et la Mannschaft vers les sommets dans les années 70, décennie au cours de laquelle Kaiser Franz remporte en toute simplicité trois Bundesliga, trois C1 consécutives, une Coupe du Monde et un Euro. Si on ajoute à ce palmarès impressionnant deux Ballons d'Or en 1972 et 1976 et un titre de champion du monde 1990 comme sélectionneur, on peut comprendre qu'à l'instar de Cruyff le bonhomme puisse à l'occasion se sentir en droit d'exprimer ses vues sur la chose footballistique.
Laurent Blanc (France, né en 1965)
 A
l'aise balle au pied car milieu de terrain offensif de formation,
remarquable relanceur plein de calme et d'assurance, joueur
supérieurement intelligent tactiquement et doté d'un jeu de tête
redoutable, Blanc possède toutes les qualités du grand libero. Alors
qu'il fait incontestablement partie des meilleurs défenseurs des années
90, il n'a jamais réussi à s'imposer à l'étranger, pas même à Barcelone,
une équipe qui semblait faite pour lui, et son maigre palmarès en club
ne reflète en rien son immense talent. C'est sur le tard et avec
l'équipe de France que le Président, qui a porté près de cent fois la
tunique bleue entre 1988 et 2000, a marqué les esprits et gagné sa place
dans l'histoire du jeu.
A
l'aise balle au pied car milieu de terrain offensif de formation,
remarquable relanceur plein de calme et d'assurance, joueur
supérieurement intelligent tactiquement et doté d'un jeu de tête
redoutable, Blanc possède toutes les qualités du grand libero. Alors
qu'il fait incontestablement partie des meilleurs défenseurs des années
90, il n'a jamais réussi à s'imposer à l'étranger, pas même à Barcelone,
une équipe qui semblait faite pour lui, et son maigre palmarès en club
ne reflète en rien son immense talent. C'est sur le tard et avec
l'équipe de France que le Président, qui a porté près de cent fois la
tunique bleue entre 1988 et 2000, a marqué les esprits et gagné sa place
dans l'histoire du jeu.Indéboulonnable patron de la meilleure défense tricolore de tous les temps aux côtés de Desailly, il plante le but en or en huitièmes face au Paraguay en 1998 et marque contre le Danemark le premier but des Bleus lors de l'Euro 2000. Sans doute pas reconnu à sa juste valeur jusqu'à ce retentissant doublé qui vient couronner sa fin de carrière, Blanc, toujours constant dans la performance, prouve enfin aux yeux du monde qu'il a la classe des plus grands et cloue le bec aux derniers sceptiques. En 2000, il est élu quatrième joueur français du siècle par le journal L'Equipe, derrière Platini, Zidane et Kopa. Rien que ça.
Frank De Boer (Pays-Bas, né en 1970)
 Sélectionné à 113 reprises sous le maillot orange
(seul Van der Sar a fait mieux) entre 1990 et 2004, De Boer fut
exceptionnel lors de la Coupe du Monde 1998, où la redoutable charnière
que ce défenseur central de poche (1,79m sous la toise) formait avec
l'ami poète Jaap Stam n'avait pas grand-chose à envier à celle des
Bleus. Sorte de grand frère pour la ribambelle de talents précoces qui
offrirent la C1 à l'Ajax en 1995, il fit le choix de rester trois
saisons supplémentaires dans son club formateur, avant de rejoindre en
compagnie de son jumeau Ronald les rangs du FC Barcelone, entraîné à la
fin des années 90 par son ancien mentor Van Gaal.
Sélectionné à 113 reprises sous le maillot orange
(seul Van der Sar a fait mieux) entre 1990 et 2004, De Boer fut
exceptionnel lors de la Coupe du Monde 1998, où la redoutable charnière
que ce défenseur central de poche (1,79m sous la toise) formait avec
l'ami poète Jaap Stam n'avait pas grand-chose à envier à celle des
Bleus. Sorte de grand frère pour la ribambelle de talents précoces qui
offrirent la C1 à l'Ajax en 1995, il fit le choix de rester trois
saisons supplémentaires dans son club formateur, avant de rejoindre en
compagnie de son jumeau Ronald les rangs du FC Barcelone, entraîné à la
fin des années 90 par son ancien mentor Van Gaal.Symbole d'une génération plus que talentueuse mais qui n'a jamais rien gagné sur la scène internationale, l'infortuné De Boer, malgré une carrière exemplaire, restera toujours le joueur qui réussit le tour de force de rater deux tirs aux buts lors de la demie-finale de l'Euro 2000 contre l'Italie, dont un dans le temps réglementaire. L'Histoire étant souvent cruelle avec les grands joueurs discrets, on se souvient moins de son ouverture de 60 mètres pour Bergkamp sur le but de la victoire en quarts du Mondial 98 face à l'Argentine.
Fernando Hierro (Espagne, né en 1968)
 Plutôt
du genre lourd et lent, Hierro, longtemps milieu de terrain aussi
bien en club qu'en sélection, n'était pas un très bon défenseur sur
l'homme, contrairement à ce que son patronyme laisserait entendre. Mais
associé à un véritable stoppeur de métier comme Sanchis et soulagé des
tâches ingrates, il s'avérait souvent précieux et précis dans la relance
et et savait mettre son équipe dans le sens de la marche. Réputé pour
sa frappe exceptionnelle et son adresse sur penalty, il a marqué plus de
cent buts pour le compte du Real Madrid, finissant même à la deuxième
place du classement des buteurs en 1992 avec 21 réalisations.
Plutôt
du genre lourd et lent, Hierro, longtemps milieu de terrain aussi
bien en club qu'en sélection, n'était pas un très bon défenseur sur
l'homme, contrairement à ce que son patronyme laisserait entendre. Mais
associé à un véritable stoppeur de métier comme Sanchis et soulagé des
tâches ingrates, il s'avérait souvent précieux et précis dans la relance
et et savait mettre son équipe dans le sens de la marche. Réputé pour
sa frappe exceptionnelle et son adresse sur penalty, il a marqué plus de
cent buts pour le compte du Real Madrid, finissant même à la deuxième
place du classement des buteurs en 1992 avec 21 réalisations.Il fut l'un des piliers de la maison blanche pendant une quinzaine d'années, avec qui il a disputé plus de 400 matches et remporté cinq fois la Liga et trois fois la Champions League. Avec 29 buts en 89 apparitions sous le maillot de la Roja, total remarquable pour un joueur défensif, il est le troisième meilleur buteur de l'histoire de la sélection espagnole, derrière Raul et Villa mais devant des cadors comme Morientes et Butragueno. Joueur au profil atypique, Hierro a su faire de sa sobriété un atout indispensable au royaume du glamour.
Ronald Koeman (Pays-Bas, né en 1963)
 Du
genre plutôt pachydermique, le Hollandais s'est rendu célèbre par
ses frappes de mammouth et la qualité extraordinaire de son jeu long,
qui fit de lui la rampe du lancement idéale du Barça de Johan Cruyff.
Autre milieu reconverti arrière central lors de son passage à l'Ajax,
Koeman a inscrit près de 200 buts au cours de sa carrière, ce qui fait
de lui l'un des défenseurs les plus prolifiques de l'histoire du jeu.
Champion d'Europe en 1988 avec le trio Rijkaard-Gullit-Van Basten,
Koeman a offert au FC Barcelone son premier titre continental en 1992
sur un maître coup franc des trente mètres inscrit dans les
prolongations de la finale de Wembley contre la Sampdoria, devenant l'un
des héros du peuple blaugrana.
Du
genre plutôt pachydermique, le Hollandais s'est rendu célèbre par
ses frappes de mammouth et la qualité extraordinaire de son jeu long,
qui fit de lui la rampe du lancement idéale du Barça de Johan Cruyff.
Autre milieu reconverti arrière central lors de son passage à l'Ajax,
Koeman a inscrit près de 200 buts au cours de sa carrière, ce qui fait
de lui l'un des défenseurs les plus prolifiques de l'histoire du jeu.
Champion d'Europe en 1988 avec le trio Rijkaard-Gullit-Van Basten,
Koeman a offert au FC Barcelone son premier titre continental en 1992
sur un maître coup franc des trente mètres inscrit dans les
prolongations de la finale de Wembley contre la Sampdoria, devenant l'un
des héros du peuple blaugrana.Sacré quatre fois consécutives champion d'Espagne entre 1991 et 1994, il exerce une influence considérable sur le jeu de l'équipe, régalant ses partenaires de transversales millimétrées, et plante en moyenne plus de dix pions par saison. De retour au pays pour la fin de sa carrière, Koeman présente la particularité d'avoir joué pour les trois clubs hollandais majeurs: le PSV, l'Ajax et le Feyenoord.
Ruud Krol (Pays-Bas, né en 1949)
 Ruud
Krol, défenseur de l'irrésistible équipe de l'Ajax du début des années
70, qui se voyait souvent élu célibataire le plus séduisant du pays par
ses compatriotes de sexe féminin, a commencé sa carrière comme latéral,
avant de remplacer Vasovic au poste crucial de libero à vingt piges et
des poussières. Triple champion d'Europe avec les rouge et blanc et
fidèle à son club formateur tout au long des années 70, il fut un des
derniers membres de la génération dorée à quitter le nid en signant au
Napoli en 1980. Il fut élu meilleur étranger du championnat d'Italie dès
sa première saison.
Ruud
Krol, défenseur de l'irrésistible équipe de l'Ajax du début des années
70, qui se voyait souvent élu célibataire le plus séduisant du pays par
ses compatriotes de sexe féminin, a commencé sa carrière comme latéral,
avant de remplacer Vasovic au poste crucial de libero à vingt piges et
des poussières. Triple champion d'Europe avec les rouge et blanc et
fidèle à son club formateur tout au long des années 70, il fut un des
derniers membres de la génération dorée à quitter le nid en signant au
Napoli en 1980. Il fut élu meilleur étranger du championnat d'Italie dès
sa première saison.Arrière gauche lors de la finale perdue face à l'Allemagne en 1974, c'est en tant que capitaine et véritable libero derrière la défense qu'il disputa le Mondial 1978, conclu par une nouvelle désillusion contre l'Argentine. Régulièrement appelé en équipe nationale de 1969 à 1983, Krol, un des symboles polyvalents du fameux "football total" prôné par Rinus Michels, se hissa à la troisième place du classement du Ballon d'Or 1979 derrière Keegan et Rummenigge et resta recordman du nombre de sélections jusqu'en 2000. Curieusement, c'est à l'AS Cannes que ce très grand joueur termina sa carrière en 1986.
Daniel Passarella (Argentine, né en 1953)
 Avant
de devenir sélectionneur de l'Albiceleste et d'exiger de Redondo qu'il
se coupe les cheveux, Daniel Passarella fut un défenseur extraordinaire,
capitaine de l'équipe d'Argentine championne du monde en 1978 au terme
d'une compétition certes très controversée. Très porté vers le but
adverse, dominateur dans le jeu aérien malgré son 1,73m et doté d'un
tempérament bouillant, celui que les supporters argentins surnommèrent
El Gran Capitan ou El Pistolero n'hésitait pas à se servir de ses coudes
et à poser de spectaculaires taquets si nécessaire.
Avant
de devenir sélectionneur de l'Albiceleste et d'exiger de Redondo qu'il
se coupe les cheveux, Daniel Passarella fut un défenseur extraordinaire,
capitaine de l'équipe d'Argentine championne du monde en 1978 au terme
d'une compétition certes très controversée. Très porté vers le but
adverse, dominateur dans le jeu aérien malgré son 1,73m et doté d'un
tempérament bouillant, celui que les supporters argentins surnommèrent
El Gran Capitan ou El Pistolero n'hésitait pas à se servir de ses coudes
et à poser de spectaculaires taquets si nécessaire.Figure emblématique de River Plate, dont il porta les couleurs pendant huit saisons et est aujourd'hui le président, Passarella passa six saisons en Italie sans remporter le moindre trophée avec la Fiorentina puis l'Inter avant de retourner au pays. Il fut sans doute le premier "défenseur offensif" de l'histoire du Calcio. Retenu pour la Coupe du Monde 1986 mais diminué par une maladie, il ne disputa pas une seule minute du tournoi et déclara par la suite que Maradona et le sélectionneur Bilardo, avec qui ses relations étaient plus que tendues, s'étaient concertés pour le laisser sur le banc: réaction typique d'un personnage haut en couleurs et pas toujours très sympathique.
Gaetano Scirea (Italie, 1953-1989)
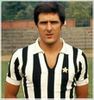 Libero
mythique de la Juventus de 1974 à 1988, Scirea s'est forgé avec la
Vieille Dame un palmarès en béton armé. En plus de ses sept Scudetti, il
fait partie avec ses coéquipiers Tardelli et Taccone des six joueurs à
avoir remporté les trois Coupes d'Europe qui existaient à l'époque.
S'efforçant de faire sortir le libero de son rôle restrictif et purement
défensif, souvent impliqué dans la construction du jeu, Scirea a
grandement contribué à l'évolution du poste. Réputé pour son fair play
et son attitude irréprochable, il n'a jamais reçu le moindre carton
rouge au cours d'une carrière professionnelle longue de plus de quinze
ans, et inspirait le plus grand respect à ses adversaires et
partenaires.
Libero
mythique de la Juventus de 1974 à 1988, Scirea s'est forgé avec la
Vieille Dame un palmarès en béton armé. En plus de ses sept Scudetti, il
fait partie avec ses coéquipiers Tardelli et Taccone des six joueurs à
avoir remporté les trois Coupes d'Europe qui existaient à l'époque.
S'efforçant de faire sortir le libero de son rôle restrictif et purement
défensif, souvent impliqué dans la construction du jeu, Scirea a
grandement contribué à l'évolution du poste. Réputé pour son fair play
et son attitude irréprochable, il n'a jamais reçu le moindre carton
rouge au cours d'une carrière professionnelle longue de plus de quinze
ans, et inspirait le plus grand respect à ses adversaires et
partenaires.Même le grand Baresi dut attendre que Scirea, titulaire indiscutable au sein de la Squadra Azzura championne du monde 1982, prenne sa retraite internationale après 78 capes pour s'imposer en sélection. Tué à 36 seulement dans un tragique accident de la route en Pologne, Gaetano Scirea occupe une place toute particulière dans le coeur des tifosi de la Juve et de la Nazionale.
Marius Trésor (France, né en 1950)
 La
présence du grand Marius dans cette sélection pourrait suprendre, tant
on est porté à croire que le Guadeloupéen brillait avant tout par sa
puissance physique et ses qualités de défenseur pur. Mais Trésor,
avant-centre éphémère de l'AC Ajaccio à son arrivée en métropole,
possédait de solides bases techniques et n'était pas franchement embêté
avec le ballon. Délié, puissant et plutôt rapide pour son gabarit, il
était capable de montées aussi spectaculaires qu'efficaces, et serait
sans doute un numéro 6 d'exception dans le football d'aujourd'hui.
C'est pour lui laisser exprimer ses qualités balle au pied que ses
entraîneurs lui associaient de préférence un défenseur plus rugueux et
dur sur l'homme, comme par exemple Janvion, surnommé "le Cerbère", avec
qui il formait la charnière centrale de l'équipe de France en 1982.
La
présence du grand Marius dans cette sélection pourrait suprendre, tant
on est porté à croire que le Guadeloupéen brillait avant tout par sa
puissance physique et ses qualités de défenseur pur. Mais Trésor,
avant-centre éphémère de l'AC Ajaccio à son arrivée en métropole,
possédait de solides bases techniques et n'était pas franchement embêté
avec le ballon. Délié, puissant et plutôt rapide pour son gabarit, il
était capable de montées aussi spectaculaires qu'efficaces, et serait
sans doute un numéro 6 d'exception dans le football d'aujourd'hui.
C'est pour lui laisser exprimer ses qualités balle au pied que ses
entraîneurs lui associaient de préférence un défenseur plus rugueux et
dur sur l'homme, comme par exemple Janvion, surnommé "le Cerbère", avec
qui il formait la charnière centrale de l'équipe de France en 1982.A jamais associé dans la mémoire nationale à la demie-finale dantesque de Séville, lors de laquelle il donna l'avantage aux Bleus d'une superbe reprise de volée sous la barre de Schumacher, Trésor a porté 65 fois le maillot tricolore. Monstre de régularité, il a disputé plus de 500 matches de championnat de France, donnant ses plus belles années à l'OM, même si c'est avec les Girondins de Bordeaux qu'il gagna son seul et unique titre de champion au terme de sa dernière saison.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire